2015
Antoine BASSET, « Pour en finir avec l’interprétation. Usages des techniques d’interprétation dans les jurisprudences constitutionnelles française et allemande », LGDJ, 2015
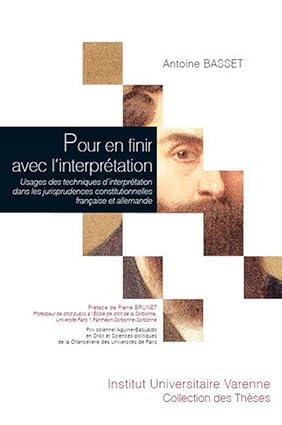
Lire le compte-rendu
Antoine Basset souligne que l’on a du mal à pouvoir faire un renvoi dans l’analyse du discours juridique et des normes à un auteur bien identifié et cela malgré la théorie dominante depuis le XVIIème siècle qui rattache le droit à la manifestation d’une volonté et l’interprétation à la recherche de la signification de cette volonté. « Ce qui manque au droit, c’est qu’il n’y a pas d’auteur car il ne peut y avoir de concomitance exacte entre l’édiction de l’énoncé normatif et son application. Même dans le cas où existe une personne physique identifiable à qui on peut rattacher un énoncé normatif, le fait que le droit consiste en des normes qui ne coïncident pas avec cet énoncé, mais avec ‘le sens ou la signification de l’acte ou des actes qui forment le processus de production des lois ‘ (Kelsen), un sens confié à un juge, empêche toute coïncidence entre l’énonciateur du texte et celui de la norme » (p. 38). A. Basset fait également plus simplement état des difficultés à appliquer empiriquement le concept de volonté du législateur ou du constituant.
Pour autant, « il n’est pas impossible que la construction de l’interprétation des textes énoncés par le constituant ou le parlement puisse être rapportée à un auteur entendu comme fonction d’autorité sans qu’il soit besoin d’une personne physique auquel le rattacher ». La référence à cet auteur et à une autorité permet de faire du droit un discours, de le penser comme la communication d’un commandement et à légitimer le discours du juge.
Reste alors à comprendre comment, derrière le recours à des techniques et des méthodes d’interprétation qui prétendent le plus souvent être celles permettant de trouver la volonté du constituant, mais qui échouent à le faire, le juge peut construire un auteur à qui rattacher l’autorité du droit et donc l’autorité des jugements et des discours du juge.
Antoine Basset propose une hypothèse de travail qui lui servira à construire une démonstration menée à partir de l’analyse des décisions des cours constitutionnelles.
« Nous émettons l’hypothèse suivante : pour constituer un corpus de normes leur permettant de répondre aux questions auxquelles elles sont confrontées sans laisser l’impression d’agir au coup par coup en l’absence de toute autorité légitimante sur laquelle elles pourraient s’appuyer, les cours constitutionnelles se livrent à une écriture constitutionnelle hypertextuelle ». Plus précisément et en faisant un détour par la théorie littéraire, ici plus particulièrement par la théorie de l’hypertextualité de Gérard Genette (Palimpsestes. La littérature au second degré, Le Seuil, 1992), il propose de regarder le travail du juge comme une écriture constitutionnelle « à partir d’autres sources » qui « lui permet à la fois de trouver une norme plus précise lui permettant de décider en préservant aux yeux de son auditoire sa neutralité et d’utiliser des éléments déjà suffisamment acceptés pour pouvoir justifier la décision » (p. 29).
Antoine Basset se demande si cela fait une différence de parler d’ « écriture constitutionnelle » plutôt que d’interprétation ou de méthodes d’interprétation. Il reconnaît qu’il introduit une distinction là où il n’est pas une différence de nature car, dans les deux cas, « une norme est énoncée à partir d’un texte de norme, que le lien soit plus ou moins aisé à faire entre les deux ». Cependant, ce « déplacement de perspective » justifie le recours à la théorie littéraire et aux concepts de Genette. Car « la question n’est, de toutes manières, pas de savoir si la solution du juge découle bien du ou d’un texte, mais d’étudier les modes de légitimation de cette solution ». Or il semble que le détour et ce déplacement de perspective offrent de nouvelles façons de présenter le travail du juge et une meilleure façon de comprendre ce qui est donc en cause dans le projet d’une théorie du droit pour l’auteur, c’est-à-dire rendre compte de la légitimation du juge, ici du juge constitutionnel.
La démonstration est faite plus précisément à partir de l’étude des méthodes du Conseil constitutionnel et de la Cour constitutionnelle allemande. Elle est construite à partir des concepts proposés et transposés par l’auteur au domaine du droit par Genette et notamment à partir de la distinction centrale qui est faite dans les procédés qui permettent de construire le rapport entre l’hypertexte et les textes de référence (l’hypotexte) : la distinction entre le procédé de l’ « imitation » et le procédé de la « transformation ».
Le procédé de l’imitation est un procédé approfondi sur le plan intellectuel car il passe par la recherche d’abord des caractères essentiels du texte de référence et il suppose la maîtrise de certains de ses caractères que l’on a choisi d’imiter. La transformation est une opération plus brutale. Pour transformer un texte, il suffit d’un geste simple et mécanique. Dans l’analyse du travail des cours constitutionnelles, l’imitation rend compte des procédés qui cherchent à dégager à partir du texte constitutionnel ou des sources théoriques qui lui sont liées, un système politique rationnel et cohérent (une théorie constitutionnelle de la démocratie par exemple), puis à en déduire des normes à appliquer dans un cas soumis au juge. Mais, par ailleurs, il se peut aussi que l’écriture constitutionnelle se contente de se construire plus mécaniquement à partir de l’utilisation de concepts ou de textes sans un travail intellectuel approfondi. Ainsi, « pour que ces nouveaux énoncés apparaissent comme du droit positif, ils nous semblent pouvoir être produits de deux manières : ou bien en se prétendant déduits rationnellement de ce texte, ou bien en répétant exactement quoique dans un contexte différent des énoncés déjà reconnus comme normatifs ».
Sur la base de ces concepts, l’auteur va mener d’abord, dans une première partie, une analyse empirique à partir d’un vaste ensemble de décisions des deux cours constitutionnelles. Cette analyse empirique va montrer la portée heuristique de l’approche théorique. On ne sait qu’admirer le plus, la qualité exceptionnelle des analyses des jurisprudences constitutionnelles les plus diverses des deux cours constitutionnelles (la doctrine de la constitution comme ordre de valeurs en RFA, les jurisprudences construites par référence à la dignité de la personne humaine, les jurisprudences sur la protection du droit à une vie familiale en cas d’expulsion d’un étranger, la jurisprudence sur la fidélité fédérale, la jurisprudence du CC sur l’article 17 de la DDHC et l’articulation de la protection de la propriété entre les articles 17 et 2 de la DDHC, la jurisprudence sur la sécurité juridique, la doctrine de la protection de la liberté individuelle, la référence aux intérêts fondamentaux de la Nation) ou la démonstration de la pertinence du « déplacement de perspective » qui permet de convaincre le lecteur de l’intérêt éminent de la transposition à l’analyse juridique des concepts d’imitation et de transformation.
L’auteur fait tout particulièrement la démonstration par exemple de la « possibilité, en adoptant ce point de vue légèrement décentré, de surmonter et d’aller au-delà de certaines des ambiguïtés qui apparaissent fréquemment lorsqu’il est question des techniques d’interprétation ». Lui-même avait annoncé ces apports dans son introduction : « L’interprétation systématique par exemple peut avoir le double sens que la cohérence que nous venons d’évoquer (cohérence comme non contradiction ou cohérence axiologique) et finir par ne plus rien désigner de précis ; l’interprétation historique, on le sait, peut être objective ou subjective, originaliste ou intentionniste. En passant par le concept d’imitation, on pourra rendre compte de la jurisprudence en évitant les imprécisions inhérentes à ces expressions ».
Il fait également la démonstration de l’utilité de la distinction entre les procédés de l’imitation et de la transformation pour distinguer aussi les deux cours constitutionnelles, la cour allemande, plus forte sans doute dans sa capacité à jouer un rôle constructeur dans l’interprétation de la Constitution, ayant plus recours à l’ « imitation » que le Conseil constitutionnel qui fait en revanche plus aisément recours à des procédés moins créateurs de la simple « transformation ».
La deuxième partie (« Interprétation et intégration ») constitue un prolongement de la première partie. Elle consiste à prolonger, dans l’étude des rapports des cours constitutionnelles avec leurs auditoires (la société, le législateur, les juges ordinaires), la trace de la distinction déjà mise en évidence dans la première partie entre les deux cours constitutionnelles. La cour constitutionnelle allemande, plus portée sur la construction théorique et politique de la Constitution, entretient des rapports plus entreprenants avec le législateur (pas de recours à la doctrine des questions politiques, pas de principe de retenue à l’égard du législateur) et avec les juges ordinaires (construction d’une jurisprudence sur l’effet horizontal des droits fondamentaux permettant un empiètement de la Constitution sur tous les champs du droit) que ne le fait le Conseil constitutionnel (on retiendra en particulier l’originalité et la qualité dans l’analyse par l’auteur des relations du Conseil constitutionnel avec le Conseil d’Etat et la Cour de cassation dans le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité).
On soulignera aussi la discussion ouverte avec l’analyse de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande des thèmes et théories du néoconstitutionnalisme.
Antoine Basset a rempli son objectif : « Dépasser les débats infinis et, dans une certaine mesure, aporétiques portant sur l’intention du législateur, ici du constituant, en droit ». « On ne cherchera pas à savoir si le sens de la constitution est celui que voulait lui donner le constituant ou celui qui ressort objectivement du texte. On ne se demandera pas non plus si l’intention du constituant est celle qu’avaient les personnes physiques à l’époque (lesquelles ?) ou celles qu’elles auraient aujourd’hui, compte tenu de l’évolution de la société. Au lieu de cela on constate dans les faits, et en s’en contente, qu’un sens est attribué par ses interprètes au texte constitutionnel et qu’ainsi surgit un auteur tel que le conçoit Foucault, c’est-à-dire une fonction-auteur à laquelle on assigne un discours ».
On a apprécié que dans sa référence aux théories réalistes de l’interprétation, l’auteur ait choisi, il l’écrit très explicitement, de s’en tenir à une analyse purement institutionnelle : sa théorie de la décision judiciaire n’emprunte pas le chemin, sous le prétexte d’une analyse empirique, d’une réduction du droit à des faits psychologiques, sociologiques ou politiques se rapportant au comportement des juges. Mais on aurait apprécié que l’auteur approfondisse ce choix méthodologique fondamental. Sur le plan théorique, on pourrait demander une meilleure explication de son travail dans ses rapports avec la théorie de l’interprétation comme argumentation chez Perelman (auquel il est fait référence dans l’introduction). Toujours sur le plan théorique encore, on pourrait demander à l’auteur si en recherchant l’autorité du droit en tant que discours du côté d’un auteur, ici d’une fonction-auteur, il ne reste pas encore inscrit dans la tradition du droit comme commandement.
Jean-Yves Chérot
2014
Véronique Champeil-Desplats, Méthodologie du droit et des sciences du droit, Dalloz, coll. Méthodes du droit, 2014, 432 pages.
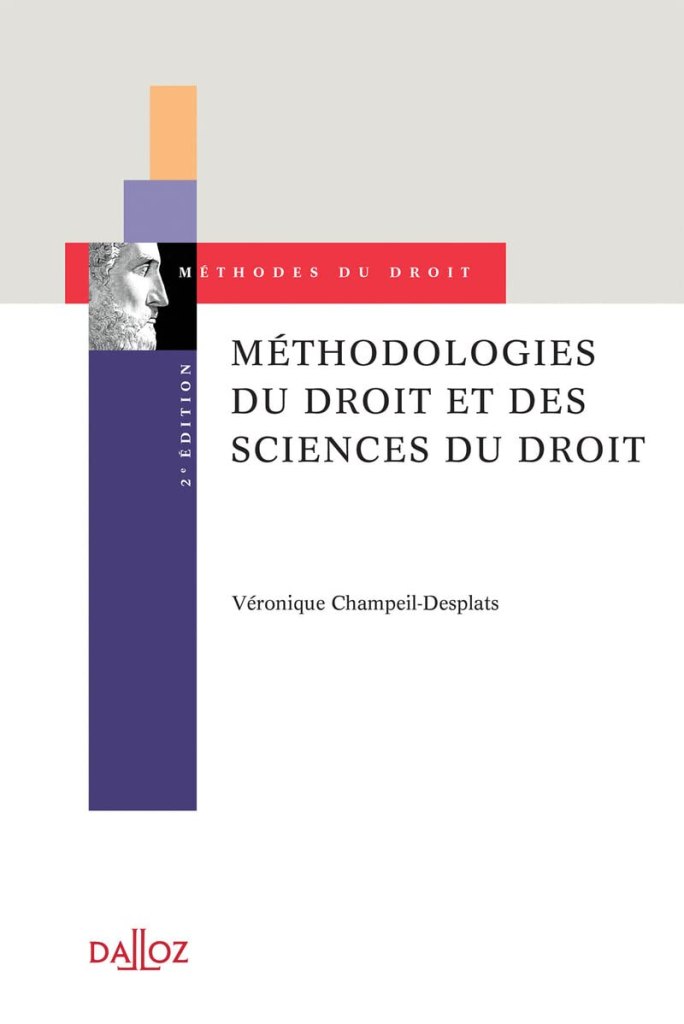
Lire le compte-rendu
L’ouvrage de Véronique Champeil-Desplats retiendra particulièrement l’attention de l’Association internationale de méthodologie juridique. Comme le titre du livre l’indique et dans la lignée de la théorie analytique du droit, l’auteur distingue le discours du droit et le discours sur le droit, voire les discours qui portent eux-mêmes sur la science du droit. Mais bien sûr il n’est pas impossible que le discours sur le droit soit lui-même regardée dans une certaine approche philosophique du droit comme la meilleure présentation du discours juridique lui-même. La méthodologie du droit et la méthodologie de la science du droit se rejoignent ainsi souvent, ce que l’observation des pratiques des sciences du droit permet de constater. Car l’approche de l’auteur est, tout en défendant le modèle analytique, notamment dans sa version de la philosophie analytique du droit italienne depuis N. Bobbio et de ces célèbres distinctions, est de faire une large place, comme le titre de l’ouvrage l’indique aussi à toutes les méthodologies de la science du droit. Elles sont évoquées et présentées sous leur meilleur jour dans une première partie où domine une approche de l’histoire de la pensée juridique dans le champ de l’épistémologie juridique. « Il ne s’agira pas ici de prescrire, écrit l’auteur, ce qui doit être considéré comme de la science du droit en général, mais de décrire et de rendre compte de la façon la plus large possible des méthodologies et des méthodes sur lesquelles les juristes s’appuient lorsqu’ils prétendent faire de la science. Or, il n’existe pas une seule façon de pré- tendre faire de la science du droit, mais plusieurs qui se succèdent historiquement ou se font à un moment donné une plus ou moins grande « amicale-hostile » concurrence (…). On portera dès lors crédit à l’ensemble des prétentions à la scientificité des discours des juristes, non pas par pure bienveillance ou esprit œcuménique, mais dans la stricte mesure où ces discours s’accompagnent d’un programme méthodologique, plus ou moins construit, élaboré, précis, cohérent, et que ce programme vise à ériger le savoir des juristes au rang de science » (p. 27).
Tout en accordant légitimement une place substantielle à la pensée juridique en France, l’ouvrage s’inscrit dans une dimension internationale avec un vaste appareil de références internationales. On sera particulièrement sensible aux fidèles restitutions de l’école de la théorie analytique italienne (voire notamment les conceptions de la validité en droit de Bobbio) et encore tout particulièrement aux démonstrations précises et si profondes sur les usages différents de la logique dans les différents types de théories du droit contemporaines.
Cette première édition est déjà un classique auquel on souhaite une longue vie au service de la théorie et de la méthodologie du droit. L’ouvrage s’inscrit dans la longue durée. Il n’en sera pas moins important au moment même où la montée en puissance de l’évaluation de la recherche va conduire dans des contextes nouveaux et parfois difficiles les juristes à devoir justifier des critères de scientificité et de pertinence de leur recherche et leur capacité de dialoguer avec les autres discipli- nes sur les divers modes de validation et d’administration de la preuve de leurs savoirs et de leurs connaissances.
Jean-Yves Chérot
V. également le compte rendu de N. Hakim, Véronique Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Dalloz, Méthodes du droit, 2014, 432 p. », Revue trimestrielle de droit civil, 2014, n° 3, p. 740-744.
Mathieu Carpentier, Norme et exception. Essai sur la défaisabilité en droit, Institut universitaire de Varennes, 2014.

Lire le compte-rendu
Le terme et la notion de defeasibility n’ont pas pénétré très avant dans le vocabulaire juridique en France. La notion est pourtant très présente sur le plan international (V. notamment Ferrer and Ra i, eds., The Logic of Legal Requirements : Essays on Defeasibility, OUP, 2013). Cette notion a été pour la première fois proposée par Hart, en 1948, de façon intuitive pour faire observer que dans l’application des règles juridiques, il était toujours possible de faire jouer, contre une solution découlant de l’application des règles, des exceptions défaisant la solution initialement défendue. Ces exceptions sont le plus souvent contenues dans d’autres règles de droit. Mais ce que Hart voulait indiquer était que dans l’application du droit, les exceptions légales n’étaient pas à placer sur le même plan que les conditions légales d’application d’une règle. Hart n’a pas donné suite à une telle intuition par la suite ; il n’a plus utilisé le terme dans ses travaux ultérieurs. S’il a proposé plus tard de prendre en considération ce qu’il a appelé la texture ouverte du langage et du droit, c’est certainement à d’autres aspects des règles de droit et à d’autres enjeux théoriques dans l’application des règles qu’il a fait référence.
Pourtant, ce terme de defeasibility, littéralement intraduisible en français, Mathieu Carpentier faisant le choix du terme de « défaisabilité », a connu un très grand succès, d’abord en dehors de la théorie du droit, dans les champs de la philosophie morale, des théories de l’argumentation, ou encore dans le champ des logiques non monotones ou de l’intelligence artificielle, avant de revenir dans le champ du raisonnement juridique et dans la théorie du droit. La notion connaît un véritable e et de mode, le terme étant utilisé maintenant couramment dans de très nombreuses théories du droit. Les occurrences sont assez rares dans la littérature francophone (voir cependant son utilisation dans la thèse de Stefan Gol berg, Théorie bidimensionnelle de l’argumentation juridique. Présomptions et argumentation a fortiori, Bruylant, 2012).
Dans cet Essai sur la défaisabilité en droit, Monsieur Carpentier examine deux séries de questions. Dans la lignée même de la pensée de Hart – que l’auteur restitue avec délité d’une façon approfondie et sans égal, même dans la littérature en anglais – Mathieu Carpentier présente d’abord la défaisabilité dans l’argumentation et le raisonnement juridique. Il examine le rôle joué par les exceptions légales explicites. Il montre que du point de vue de la pratique juridique ces exceptions ne sont pas de simples conditions légales d’application de la règle. Cette analyse processuelle de l’argumentation juridique est précédée par une démonstration préalable, à l’aide des logiques non monotones, des subtilités logiques du jeu des exceptions dans l’argumentation en général.
Mais là ne réside pas le seul apport de Mathieu Carpentier. Son projet est beaucoup plus vaste puisqu’il s’agit d’examiner non pas les seules exceptions explicites dans l’application des règles de droit, mais le jeu, dans l’application de la règle de droit, d’exceptions implicites de toute nature, en particulier le jeu que peuvent jouer les principes pour « défaire » les conclusions d’application des règles. Il ne s’agit plus ici de se placer sous l’angle du fonctionnement technique et procédural du raisonnement juridique, mais de proposer une réflexion conceptuelle sur la notion de règle, sur la question de savoir si le droit est bien dans les règles, et plus largement sur la nature du droit. La question est de savoir comment les théories du droit traitent de façon conceptuelle le phénomène de défaisabilité implicite à l’égard des règles et plus largement si les théories conceptuelles du droit attachent une importance particulière au phénomène de défaisabilité.
On doit observer immédiatement que parler de défaisabilité des règles suppose encore, ne serait-ce que pour des raisons logiques, que conceptuellement les règles soient des éléments centraux du droit et qu’elles soient en mesure de fonctionner pour décider du droit. L’auteur s’est positionné d’emblée contre les théories décisionnistes du droit et, en particulier, contre la théorie de Carl Schmit dans laquelle l’exception défait l’idée même de droit.
Mathieu Carpentier construit une distinction décisive entre la notion d’« applicabilité des règles » et la notion de « force normative de la règle ». L’applicabilité est la capacité théorique de la règle de permettre la subsomption des cas, une capacité cependant purement conceptuelle qui a end pour être décisive pour la solution que puisse aussi jouer la force normative de la règle et de la solution ainsi conceptuellement possible. En e et, l’auteur y revient à de nombreuses reprises : pour que la question de la défaisabilité des règles puisse avoir un sens, encore faut-il que l’on puisse partir d’une base solide à partir de laquelle la notion d’application d’une règle de droit soit compréhensible et solidement acceptée. La défaisabilité des règles n’est pas le décisionnisme ou encore le scepticisme radical à l’égard des règles. Ce n’est qu’une fois posé le concept d’applicabilité de la règle que l’on peut voir apparaître le jeu éventuel d’exceptions implicites, défaisant, à l’occasion de son application à un cas, la force normative de la règle.
L’auteur accorde dans cette perspective une grande importance à la distinction entre la défaisabilité et l’indétermination du droit et encore à l’adoption d’un concept d’interprétation qui rende intelligible la fonction de défaite de la règle. Il adopte ainsi un concept stipulatif large de l’interprétation – l’interprétation est bien une attribution d’une signification à tout énoncé – mais non sceptique – l’interprétation n’étant pas un choix arbitraire.
Dans un chapitre qui retiendra l’attention, il examine ce que les théories sur la nature du droit ont à dire de la défaisabilité en droit. Les théories positivistes peuvent admettre la défaisabilité des règles, soit comme un phénomène contingent soit comme un phénomène lié à la défaillance de la force normative du droit. Les théories jusnaturalistes en font un trait nécessaire de la nature du droit. Leur stratégie consiste à soutenir que les critères de correction des décisions juridictionnelles ne sont pas épuisés par les règles du système, mais que le droit ordonne toujours au juge de prendre la décision moralement correcte. Les conceptions antipositivistes comme celle d’Alexy attachent une importance toute particulière à la défaisabilité des règles par le jeu de l’application des principes, dès lors que, par ailleurs, elles distinguent radicalement par nature les règles et les principes.
On retiendra tout particulièrement en ce qui concerne l’examen des théories positivistes les analyses remarquables des différences entre théories du positivisme exclusif et théories du positivisme inclusif. L’auteur a ache dans ce e analyse une importance toute particulière à la théorie de la normativité juridique de Joseph Raz (un représentant éminent du positivisme exclusif) qui tend à exclure toute possibilité de défaisabilité des règles dans sa définition conceptuelle du droit.
La thèse de Monsieur Mathieu Carpentier est un travail de très grande valeur qui fait la preuve de qualités exceptionnelles de philosophe et de juriste. Ce ne sont pas moins trois champs majeurs de la théorie du droit qui sont labourés : la théorie générale des normes, l’argumentation et le raisonnement juridique, la théorie sur la nature du droit, sans compter les analyses de très grande profondeur sur l’interprétation ou sur les concepts vagues.
On pourrait être tenté par quelques critiques. Notamment, l’auteur n’a-t-il pas, pour rendre compte d’une discussion rationnelle sur la défaisabilité, écarté toutes les théories pour lesquelles la défaisabilité n’a pas de signification ? Ce e observation serait encore malheureuse. L’auteur sait très bien quel est l’enjeu de sa thèse : « il ne s’agit rien de moins que de rendre compte de façon médiane du « chaos relatif » que les exceptions implicites introduisent dans la pratique du droit ». Si les règles juridiques sont défaisables, écrit-il, c’est que la théorie qui les représentent comme telle est plus certaine de succès que, d’une part, les « théories qui nient qu’elles le soient et ramènent les exceptions implicites à des jugements contra legem » et, d’autre part, les « théories qui mettent en doute la pertinence de la notion de défaisabilité au motif que dans le droit, il n’y aurait rien à défaire en n de compte, car rien ne permet d’assurer que le droit soit véritablement un système de règles, ni que les règles y jouent un rôle particulièrement important » (p. 707). L’auteur lui-même doute de ce point : « Il n’est pas certain que l’on ait entendu apporter une réponse tranchée à la question de savoir qu’il est pertinent ou souhaitable de représenter le droit comme un modèle de règles juridiques défaisables » (p. 708).
En tout état de cause la thèse a permis de véritables démonstrations serrées et exhaustives sur des points conceptuellement importants et centraux de la théorie du droit, la restitution des concepts centraux de la théorie du droit, à la hauteur de ce qui peut en être attendu sur le plan international.
Jean-Yves Chérot
2013
Pierre Brunet, « Le raisonnement juridique : Une pratique spécifique ? », International Journal for the Semiotic of Law, Revue internationale de sémiotique juridique, février 2013
Pierre Brunet défend ici le scepticisme juridique face aux théories du droit qui proposent de présenter le raisonne- ment juridique comme le résultat d’argumentations prenant leur signification objective dans un ensemble de règles, d’institutions et de valeurs inhérentes au droit présenté par ces thèses comme une pratique sociale interprétative.
Lire la suite du compte-rendu
On retiendra d’abord la belle présentation par Pierre Brunet de la théorie du droit comme pratique sociale interprétative à partir, au-delà de leurs différences, des thèses notamment de Dworkin, Viola, Atienza, La Torre et encore MacCormick. Pierre Brunet voit dans ces théories un développement de la thèse défendue par Hart présentant, contre le mouvement du réalisme juridique sceptique, le raisonnement juridique comme une justification des décisions de justice, une justification consistant à donner des raisons objectives. Pierre Brunet souligne que dans ces théories l’activité qui consiste à donner des raisons implique un « engagement » et exerce ainsi une contrainte argumentative (une contrainte argumentative de façon rétroactive dès lors que l’intuition aurait conduit vers une autre solution et plus généralement une contrainte de cohérence entre décisions).
Selon ces théories, s’il y a bien place pour des interprétations et si le syllogisme ne peut décider à lui seul des cas qui se présentent devant le juge, l’interprétation est une argumentation selon la logique de la pratique sociale normative dans laquelle elle prend place.
Pierre Brunet affronte avec hauteur ces théories et avec d’autant plus de hauteur qu’il les a présentées sous leur meilleur jour. Elles souffrent cependant selon lui de graves objections.
En tant théories interprétatives, elles ne distinguent pas en général le point de vue des acteurs et le point de vue de la science du droit. En conséquence, la théorie du droit est elle-même un élément de la pratique sociale interprétative. Ce point de vue interne fragilise ces théories. Pierre Brunet observe qu’elles ne sont alors que de pures descriptions, voire la répétition des discours des acteurs du droit, à moins que leur signification ne soit prescriptive : car une telle description « passe sous silence que d’autres interprétations sont envisageables ». En deuxième lieu, ces théories ne se contentent pas d’indiquer que les raisons juridiques impliquent des références à des valeurs, des institutions et à des principes (ce que les réalistes sceptiques ont été parmi les premiers à mettre en évidence), elles supposent que ces choix peuvent être objectifs. Elles présupposent qu’il « existe un ensemble de croyances que la pratique d’une activité produit et qui lie et détermine les actions des acteurs et praticiens autour d’une morale institutionnelle ».
Or cela postule une objectivité morale, même si cette objectivité est une objectivité dans un certain sens, celui de la communauté ou de la forme de vie dans laquelle la pratique prend place. Enfin, Pierre Brunet admet que l’on puise considérer que la normativité de la signification dépende de la pratique d’une communauté (par référence partagée à Wittgenstein qui est aussi une référence implicite ou explicite de toutes les théories du droit comme pratique sociale interprétative). Mais, ajoute-il, encore faut-il tenir compte de cet élément particulier au droit que la « communauté se limite très largement aux autorités désignées par le système juridique », des autorités « qui imposent des significations ». Pierre Brunet souligne que le « contexte de la communication juridique qui institue une autorité qui est chargée non pas tant de trancher des désaccords que d’imposer une signification (…) ne ressemble pas au contexte de la communication ordinaire » à laquelle fait notamment référence Wittgenstein et où « aucune autorité n’est a priori désignée pour trancher un éventuel désaccord interprétatif ».
De telle sorte que si l’on devait faire référence à Wittgenstein, ce serait l’interprétation sceptique de la convention de référence proposée par Kripke qui aurait la préférence de l’auteur. La règle ne peut pas déterminer à elle seule aucune manière d’agir. Il faut selon Kripke comprendre cela comme un renouveau du scepticisme : car il n’y a pas de fait qui permette de décider de l’application correcte de la règle. La seule façon de comprendre les directions montrées par Wittgenstein serait de renvoyer (ce que Kripke appelle la « solution sceptique ») à une communauté, mais à une communauté qui ne pourrait elle-même qu’être l’ultime référence, une communauté arbi- traire dont les choix et les raisons ne garantissent l’existence d’aucune raison, d’aucune objectivité extérieure et finalement d’aucun engagement stable.
Pierre Brunet se demande pour conclure « pourquoi a-t-on besoin de faire du droit une « pratique sociale » plu- tôt qu’un « ensemble de normes » ? « En réalité, poursuit-il, dire que le droit est une pratique permet de mettre de côté le rôle des normes et la dimension prescriptive et autoritaire du langage du droit, en insistant au contraire sur la dimension pratique et rationnelle de la discussion juridique ».
On lira cet article autant par la formulations brillante des objections que par la belle présentation qui est faite des théories contestées, les théories du droit comme pratique sociale interprétative. Il constitue une introduction à un débat central de la philosophie du droit.
Jean-Yves Chérot
Georges Azzaria (dir.), Les cadres théoriques et le droit. Actes de la 2e Journée d’étude sur la méthodologie et l’épistémologie juridiques, Cowansville, Yvon Blais, 2013.
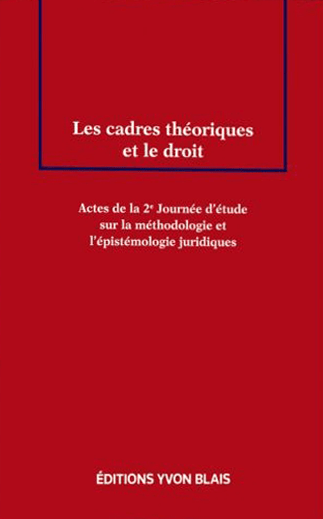
Lire le compte-rendu
Les textes de cet ouvrage regroupent la majorité des conférences prononcées lors de la 2e Journée d’étude sur la méthodologie et l’épistémologie juridiques tenue à l’Université Laval en mai 2012. Comme ce fut le cas lors de la première journée d’étude, un des buts de ces rencontres est de discuter de la portée scientifique de l’étude du droit. L’objectif plus particulier de ce=e journée était de dresser un état des lieux des cadres théoriques dans l’étude du droit. Alors que ce=e problématique paraît triviale dans des disciplines où les contours épistémologiques sont mieux tracés, elle incarne celle qu’on ne pose pas avec suffisamment d’insistance en droit. En sciences sociales, par exemple, le cadre théorique est généralement le garant de la scientificité de la démarche et plusieurs recherches constituent des études de cas tirées d’un cadre particulier.
En droit, la perspective est fort différente et les approches théoriques sont généralement peu développées. Dans la mesure où l’on pose à la doctrine l’exigence de mettre de l’ordre dans le droit, ces approches sont parfois considérées comme des obstacles pour parvenir à la connaissance du phénomène juridique. Ainsi, dans bien des recherches, il y a rarement un cadre théorique explicite et la revue de la littérature ou la définition des concepts tient ce rôle. Cela s’explique peut-être par un a priori de vocation pratique de la doctrine ou par la professionnalisation du savoir juridique. Mais cela traduit aussi une compréhension de la nature même du droit. En effet, le droit est appréhendé comme un ensemble de normes ne demandant qu’à être systématisées, la science émerge au terme d’un rigoureux travail de synthèse. La scientificité s’évalue alors à l’intensité de l’effort.
Sans cadre théorique, point de science ? L’affirmation jette un discrédit sur la doctrine dite dogmatique, trop spontanée dans son approche pour être scientifique, trop plongée dans le détail pour être consciente d’elle- même. Tel est du moins le débat auquel nous invite cet ouvrage.
Deux points focaux traversent ces actes : la nature de l’objet à l’étude et l’endroit où se place le sujet pour l’étudier. En somme, le droit et les chercheurs forment les pôles principaux d’interrogation. Ce qui est commun aux contributions des auteurs est l’idée qu’on ne possède pas un accès direct au droit. Entre le chercheur et son objet, des théories et des concepts se posent en intermédiaires. Les auteurs dits dogmatiques postulent un accès direct au droit et, ce faisant, ils méconnaissent ou sous-estiment leur pouvoir d’interprétation, leurs a priori ou leurs idéologies.
Bien qu’une intention commune des auteurs ne traverse pas cet ouvrage, l’apport d’un cadre théorique dans la démarche menant à la scientificité du droit est mis en évidence. Il n’est pas question ici de poser la recherche en droit avec les mêmes critères que les chercheurs qui identifient un virus et en découvrent les caractéristiques. Mais, à l’image du microbiologiste en laboratoire, c’est l’outil d’analyse qui permet de mesurer l’exactitude de l’hypothèse. Un cadre théorique installe les balises et les limites du savoir, un aspect décisif dans la démarche scientifique. Le pari alors tenu est que ce cadre constitue le garant de la scientificité et que cette théorie permet, avec la distance et les outils qu’elle apporte, d’expliquer le droit, du moins une partie du droit. Ces cadres peuvent être considérés comme des angles ou des perspectives qui permettent de faire apparaître certains aspects d’un phénomène qu’on ne pourrait voir autrement. Faire usage d’un tel cadre implique généralement une adhésion au postulat de la fragmentation du savoir juridique. Les textes qui suivent nous permettent d’entrer dans toute la densité de cette affirmation.
Les cadres théoriques utilisent des concepts qui ne sont pas d’abord juridiques. Ils présentent généralement une organisation de la pensée qui est extérieure au droit et qui provient d’une autre discipline. Ejan Mackaay et Alain Parent nous démontrent ainsi comment un cadre emprunté aux sciences économiques peut éclairer le raisonnement juridique et servir de révélateur lorsque vient le temps de comprendre les motivations des acteurs sociaux. Une telle analyse est utile à la fois aux juristes et aux praticiens du droit. Adoptant un angle différent, mais tout aussi intéressée par les motivations du comportement hu- main, Catherine Régis pose les balises d’une approche psychologique du droit. Alors que l’analyse économique prend appui sur la rationalité de l’individu dans le processus de décision, l’analyse psychologique table plutôt sur la présence des émotions dans ce processus. Le texte explique que les concepts développés par la psychologie sont d’un précieux secours pour saisir le rapport entre les individus et le droit, mais aussi comme outil prédictif. Utiliser la psychologie pour comprendre le droit implique une forme d’interdisciplinarité, un exercice auquel se prête Louis Emond, en abordant le droit et l’éducation, et plus particulièrement la notion de jugement. Après un détour historique, l’auteur discute l’opportunité d’exporter deux caractéristiques du jugement en droit, soit la procédure et l’intersubjectivité, à l’éducation. Le caractère heuristique des cadres théoriques est mis de l’avant par Suzanne Bouclin, qui recourt à des concepts liés à l’étude cinématographique pour analyser l’itinérance. Ainsi, le point de vue aérien permet de voir comment les personnes circulent dans une ville et de cartographier le profilage social, alors que le travelling/suivi documente les interactions quotidiennes d’une personne en situation d’itinérance avec le droit.
Plusieurs auteurs nous invitent à considérer le droit comme un fait social, comme une construction. Emmanuelle Bernheim met en évidence le fait que le droit manque parfois de nuances pour appréhender des situations complexes, notamment dans le champ de la psychiatrie. Par le biais d’une recherche empirique, l’auteure parvient à décrire l’enchevêtrement du juridique et du social. Christine Vézina, quant à elle, après avoir brossé un portrait des divers courants sociologiques de l’effectivité et guidée par une hypothèse d’effectivité internormative, indique dans quelle mesure des normes juridiques non contraignantes peuvent influencer des acteurs sociaux. Ce faisant, c’est aussi un mécanisme de production du droit qui est décrit.
Si la sociologie se révèle être un lieu naturel pour observer le droit, d’autres cadres théoriques proposent en même temps une lecture épistémologique. Par exemple, Rémi Bachand nous montre comment la théorie féministe du positionnement recèle une grille explicative qui s’applique à un nombre important de phénomènes, voire à tous les phénomènes, en procédant au forage des fondements du savoir juridique. L’auteur applique son analyse au droit international, présenté comme une pratique sociale, et fait ressortir l’apport de l’idéologie dans son interprétation. Dans une perspective qui croise les approches féministes et civilistes pour saisir la profondeur de la problématique de l’embryon congelé, Anne Saris et Gaële Gidrol- Mistral offrent une synthèse épistémologique aux accents encyclopédiques. On perçoit à quel point la doctrine n’est pas neutre et que les cadres théoriques structurent la compréhension du droit : la comparaison des cadres féministes et civilistes illustre éloquemment l’impossibilité d’un savoir unique sur le droit.
Mais ces modèles peuvent eux-mêmes être critiqués et leur portée explicative relativisée. Les trois premiers textes de cet ouvrage en sont des illustrations. D’entrée de jeu, Stéphane Bernatchez met en question la doctrine juridique et son modèle d’objectivité théorique en suggérant d’autres formes d’objectivité et d’autres modèles de connaissance : la raison pratique et le jugement réfléchissant. Les chercheurs prennent-ils la distance nécessaire pour «objectiver» le droit ? Ce questionnement épistémologique demeure au cœur de la réflexion actuelle, comme le démontre Louise Lalonde en étudiant les points de vue interne et externe, ainsi qu’en soulignant l’apport d’une méthode métathéorique réflexive pour analyser la doctrine et ses dis- cours. Quant à elles, Michelle Cumyn et Mélanie Samson avancent une proposition en porte-à-faux avec la thématique de la journée d’étude en critiquant l’empirisme logique. Les auteures posent l’interprétation comme une contre- approche et sou- mettent l’idée d’un virage herméneutique, un virage explicite et assumé, à la fois pour comprendre, critiquer et enseigner le droit. Il y a ici matière à débats pour des années à venir. Suivant ce qu’en dit Bjarne Melkevik, nous pouvons aussi aller jus- qu’à contester l’existence d’un «déjà droit», un droit qui serait déjà présent et susceptible d’être observé directement. Son texte nous entraîne dans une critique de notre définition même du droit et des conventions qui, implicitement, guident notre entendement de celui-ci.
L’interdisciplinarité et l’utilisation de cadres théoriques requièrent un effort documentaire important. Sortir de sa discipline pour importer des modèles développés dans d’autres disciplines exige de puiser dans des sources non juridiques, avec le risque d’égarement que cela implique. Les notes de bas de pages de la grande majorité des textes de cet ouvrage – lesquels forment un programme de lecture magistral – témoignent des bénéfices de puiser ailleurs que dans les banques de données juridiques. En guise de remède, Valérie Bouchard nous entraîne dans la richesse quasi infinie de la recherche documentaire. L’auteure discute une idée forte et souvent occultée, soit celle de la construction idéologique des banques de données, et elle souligne certains des enjeux de la documentation en ligne, notamment son archivage.
Ce qui ressort de ces contributions est le fait que le droit est, en lui- même, complexe, en raison de l’aspect construit de la norme et des multiples regards qui permettent de la comprendre. Trop complexe pour être appréhendé par une seule approche. Par conséquent, si chacun des cadres théoriques apporte un point de vue légitime aux phénomènes juridiques, comment choisir ? Est-ce que l’approche traduit d’abord les préférences de la personne qui effectue la recherche ? Dans ce con- texte, comment se posent les questions de la neutralité ou de l’objectivité des chercheurs ? S’agissant de la communauté fédé- rée autour de ces interrogations, nous pourrions aussi, avec le risque de tomber dans une spirale épistémologique sans fin, tenter de déterminer les fondements sur lesquels cette communauté s’est constituée, en construisant un savoir sur ce savoir.
La lecture de ces actes est parfois ardue, mais elle en vaut entièrement les efforts. Les textes renferment une somme impressionnante de saines remises en question et de concepts souvent inédits dans la littérature juridique. Déconstruire le processus menant au savoir juridique est une démarche qui devrait intéresser bien des juristes. Les auteurs ici réunis font preuve d’un certain courage épistémologique, car leur réflexion ne reflète pas toujours leur champ d’enseignement : plusieurs sont positivistes le jour et théoriciens du droit le soir.
Des remerciements vont à la Faculté de droit de l’Université Laval qui a rendu possible cet événement, ainsi qu’à Louis Bossé des Éditions Yvon Blais, qui prend le relais de cette journée d’étude en disséminant la réflexion à travers l’ensemble de la communauté juridique.
Georges Azzaria, Faculté de droit, Université Laval
2012
Heikki E.S. MATTILA, Jurilinguistique comparée. Langage du droit, latin et langues modernes, traduit vers le français par Jean-Claude GÉMAR, 2012, Cowansville, Yvon Blais

Lire le compte-rendu
Dans cet ouvrage savamment ficelé, Heikki E.S. Mattila accomplit un travail de moine en abordant d’abord en profondeur les fonctions et l’utilité de la jurilinguistique puis en développant une étude comparative de l’usage du langage du droit dans cinq grandes langues, soit le latin, l’allemand, le français, l’espagnol et l’anglais.
La section sur la jurilinguistique en elle-même traite en profondeur des fonctions du langage du droit, les principales étant de permettre la réalisation de la justice au moyen de la langue, renforcer l’esprit de groupe de la profession juridique, renforcer l’autorité du Droit ainsi que de promouvoir les politiques linguistiques et culturelles. Le caractère d’exactitude et de précision que renferme le langage du droit permet de transmettre des messages formels sans ambiguïté et est un facteur permettant de réaliser les fonctions du langage du droit. C’est par cette analyse qu’il est possible d’ensuite comprendre les nombreux entrelacs entre les différentes langues et systèmes juridiques.
Ce livre sera lu pour comprendre l’influence qu’a la linguistique sur le droit. Le langage écrit et oral étant les principaux outils du droit, il est intéressant de voir son impact sur la façon de penser le droit, de l’ordonner, de l’édicter. L’étude comparative a pour sa part la force de démontrer l’histoire que chacune des langues étudiées entretient avec le droit et les influences qu’elles ont les unes sur les autres. Dans un contexte où l’anglais devient la langue juridique dominante, il est pertinent de connaître les forces et faiblesses de l’usage de cette langue dans le droit, ainsi que comment le latin, l’allemand, le français et l’espagnol ont pu l’influencer, ce que cet ouvrage démontre largement.
Catherine Dion-Lafont, avocate et étudiante à la maîtrise (Ll.M.), Université de Sherbrooke
2011
Mireille Delmas- Marty, Les forces imaginantes du droit (IV) Vers une communauté de valeurs, Seuil, 2011
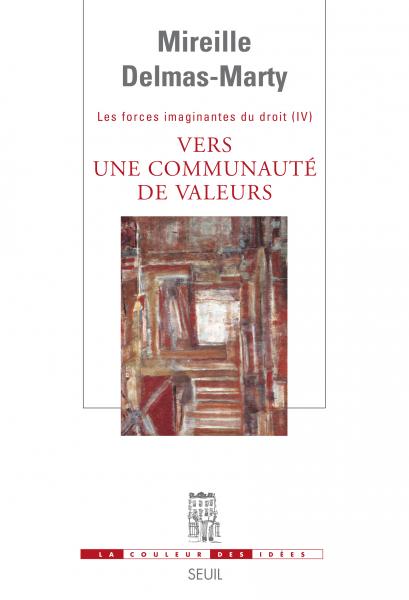
Lire le compte-rendu
En 2011, Mireille Delmas-Marty, Professeur au Collège de France, fait paraître le dernier volet du cours qu’elle dispense dans le cadre de la chaire « Etudes comparatives et internationalisation du droit ». Cet enseignement directement issu de sa recherche est publié en 4 volumes sous le titre général : Les forces imaginantes du droit. L’objet des réflexions de Mme Delmas-Marty est en fait l’émergence d’un droit commun humain, vieux thème des études juridiques à forte consonance anthropologique. Elle décline ce thème dans ce quatrième volume en abordant la question épineuse de la communauté des valeurs. La démarche aura de quoi heurter la vulgate positiviste scientifique crispée sur la séparation entre droit et morale. Mais Mireille Delmas-Marty ne remet pas en cause cette distinction. Elle fait uniquement remarquer, de façon subtile, que même s’il est à lui seul insuffisant, le droit est nécessaire à la consolidation des valeurs en les formalisant, les mettant en œuvre ; voire il peut révéler des valeurs inexprimées. Elle insiste sur la relation dialectique entre préférences éthiques et droit (p. 20). Sa dé- marche semble bien se référer à la dialectique ouverte initiée par son illustre prédécesseur au Collège de France René-Jean Dupuy. Le style interrogatif du sous-titre de l’ouvrage de Mme Delmas-Marty (vers une communauté de valeur ?) dénote une réflexion visant à appréhender l’infinitude d’un monde en transformation continue. Tout cadre systémique de pensée clos sur lui-même est ici récusé.
Mireille Delmas-Marty va s’efforcer de mettre en œuvre sa méthode originale pour démontrer le caractère opératoire d’une « intuition » (p. 189). Se référant aux leçons de l’histoire et de l’ethnologie juridiques, elle relève que les communautés humaines se sont d’abord fondées sur ce qu’elles rejetaient pénalement avant de dégager plus positivement un contenu éthique commun. Mme Delmas-Marty s’efforce donc de montrer que la Communauté humaine est en train de se constituer grâce aux interdits fondateurs du nouveau droit pénal mondial (Ière partie) et à la consécration du contenu plus positif de droits fondamentaux (IIe partie). Sans prétendre rendre compte d’une pensée dont la richesse n’a pas fini de susciter les commentaires, on voudrait en présenter quelques linéaments marquants.
Les interdits fondateurs donnent d’abord lieu à l’analyse de trois paradigmes du droit pénal international. Le premier est celui du crime de guerre visant à limiter l’inhumain. Le second est celui de la guerre contre le crime, amorcée par l’Occident depuis les attentats du 11 septembre 2001, légitimant l’inhumain par la torture appliquée à la main armée de « l’axe du mal ».
Le troisième paradigme est relatif au crime contre l’humanité faisant d’une humanité en construction une valeur. Les interdits fondateurs sont aussi appréhendés à travers différents débats autour des idées de justice internationale répressive ou restauratrice au service de l’apaisement des conflits. Mais si la Communauté humaine mondiale est une valeur en construction sur quoi la fonder sans sombrer dans un fondamentalisme visant à imposer l’hégémonie de certains sur tous les autres ?
Paradoxalement, c’est en abordant l’énigme d’une Communauté de valeurs sans fondations que Mireille Delmas-Marty aborde une appréhension plus positive de celle-ci en évoquant les droits fondamentaux. Ces derniers relèvent d’abord des droits de l’homme les plus importants qui tournent autour de l’intégrité et du respect de la vie humaine. Mais ils sont aussi constitués par des biens publics mondiaux (au sens d’affaires communes mondiales) comme la santé humaine et les ressources naturelles. Ici, Mme Delmas-Marty attire l’attention sur l’articulation nécessaire entre hominisation (développement du savoir humain) et humanisation (empêcher l’instrumentalisation des hommes par ce savoir). Comment, dès lors, dégager les valeurs communes issues d’interdits fondateurs et de droits fondamentaux alors que la Communauté humaine se constitue dialectiquement par la confrontation de groupes culturellement différents ?
Reprenant une position adoptée depuis toujours, Mme Delmas-Marty se refuse à un intégrisme universaliste ou à un relativisme nihiliste. Dans le second volume des forces imaginantes du droit, elle parlait de pluralisme or- donné pour faire coexister des ordres juridiques. Dans le volume IV, elle impartit au droit le rôle d’ordonner les valeurs communes à l’Humanité de façon «interactive et évolutive » (p. 341). Mais cet ordonnancement juridico- éthique se nourrit du pluralisme culturel animant les différents groupes formant la Communauté humaine. Il reste alors à aborder la question la plus délicate de l’ouvrage : comment ces groupes culturels pluriels vont-ils accepter de se rapprocher au sein de l’Humanité ?
A l’encontre du choc des cultures de Huntington, Mme Delmas-Marty reprend l’argument traditionnel du dialogue interculturel. On est alors fondé à se demander pourquoi les communautés culturelles en viendraient à dia- loguer. Reprenant Paul Ricoeur, Mme Delmas-Marty propose un argument original et fort. Elle indique que le débat pacifique est la suite d’un approfondissement de sa tradition culturelle par un groupe social (p. 184). Une meilleure connaissance de celle-ci ne peut conduire qu’à la discussion avec autrui. En effet, une culture est une représentation du monde. Elle permet à un groupe identitaire de développer un regard particulier sur le monde et de s’adapter au réel. Elle n’est pas un carcan visant à faire peser les morts sur la conscience des vivants.
La tradition culturelle permet à tout un chacun de s’intégrer dans la Communauté mondialisée sans se renier. Le passage de l’approfondissement d’une tradition culturelle au dialogue inter-groupal s’effectue grâce à la « traduction » (p. 184 ; p. 380). De fait, cette dernière vise à créer de la « ressemblance là où il semblait y avoir que de la pluralité » (p. 380). Le dialogue vient donc de la reconnaissance de l’humain dans les différentes cultures. Cette « issue lumineuse » (p. 377) devrait permettre, selon Mme Delmas-Marty, la reconnaissance de l’égale dignité, du développement durable et d’une éthique de la solidarité impliquant l’extension d’une responsabilité au bénéfice de l’Humanité.
Olivier Tholozan, MCF à l’Université d’Aix-Marseille Laboratoire de théorie du droit
Simone Glanert, De la traductibilité du droit, Paris, Dalloz, 2011

Lire le compte-rendu
Dans cet ouvrage, Simone Glanert traite du délicat problème de la traduction du droit. Par le biais d’une étude interdisciplinaire mobilisant à la fois les domaines de la traductologie et du droit, elle questionne dans quelle mesure le droit peut-il exister de façon significative en dehors de sa langue. À l’ère du transnationalisme, les échanges juridiques internationaux sont de plus en plus fréquents, tant dans le domaine public que privé. La traduction juridique prend alors toute son importance.
Dans un premier temps, l’auteure fait ressortir les difficultés inhérentes de la traduction en soi, en abordant les différentes théories de la traductologie. Une des embûches majeures est qu’il semble impossible pour la traduction de réellement reproduire le texte-source dans une autre langue. Plusieurs auteurs, tels Gadamer et Reiss, ont développé des théories de traduction visant à éliminer la part de subjectif de la traduction, à créer une traduction parfaite. Cependant, peu importe la technique utilisée, passant de l’approche littérale à l’herméneutisme, la traduction se butte à des embûches insurmontables, pouvant tout au plus produire un portrait ressemblant, mais en aucun cas la réplique parfaite de l’original.
Si la traduction générale pose de nombreux problèmes théoriques, le cas de la traduction juridique en est un encore plus particulier. La complexité du langage juridique, sa technicité et les nombreux sens qu’un même concept peut revêtir selon la culture où il est appliqué, de même que le manque de formation des traducteurs juridiques en droit sont des problèmes majeurs auxquels la traduction juridique est confrontée. Certaines traditions bijuridiques, comme le Canada, posent le postulat qu’il est possible de co-rédiger des lois qui seront exactement les mêmes tant en anglais qu’en français. L’Union européenne tente aussi cet exploit par la traduction de ses traités et lois dans ses langues officielles. Cependant, l’auteure démontre que malgré tous les efforts mis de l’avant, la traduction juridique n’est jamais parfaite et mène à de nombreux problèmes d’interprétation.
En somme, madame Glanert constate que la traduction juridique est impossible. Le droit reconnait de façon trop marginale les limites imposées par la langue et l’universalisme que l’on veut conférer aux principes juridiques est utopique. Au mieux il est possible de retrouver par la traduction une représentation du texte source, mais la traduction juridique, dans sa « mêmeté », est impossible. Malgré ce constat, l’auteure soutient qu’elle doit être possible. C’est donc au traducteur juridique de rendre l’impossible possible, en ayant conscience des limites inhérentes au processus de traduction.
Catherine Dion-Lafont, avocate et étudiante à la maîtrise (Ll.M.), Université de Sherbrooke
